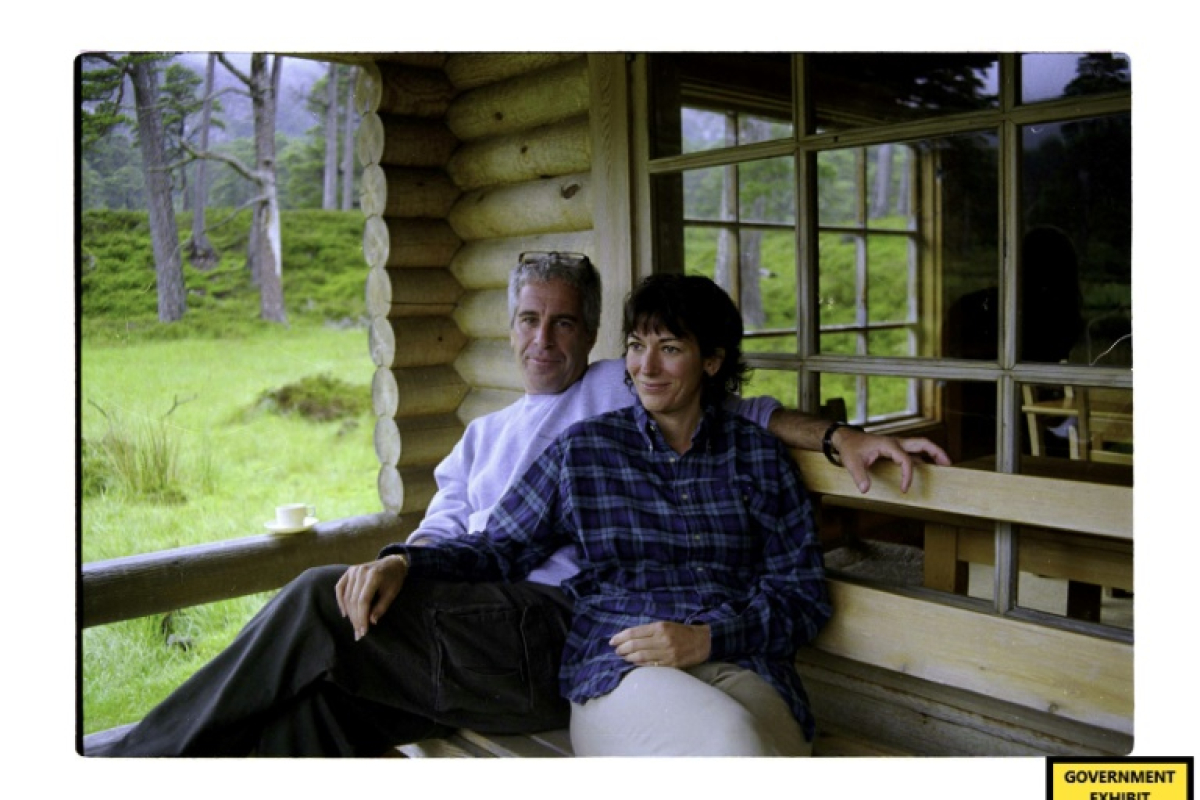Un enfant québécois peut désormais avoir plus de deux parents

Une autre frontière a été franchie vendredi en droit familial au Québec : la Cour supérieure vient de reconnaître la possibilité pour un enfant d’avoir plus de deux parents aux yeux de la loi. Jusqu’à maintenant, seuls les noms de deux parents pouvaient être inscrits sur l’acte de naissance d’un bébé — avec toutes les obligations légales et les droits qui en découlent. Cette limite a été jugée discriminatoire et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés par un jugement rendu vendredi qui n’invalide pas moins de 44 articles du Code civil du Québec. « Le modèle familial sur lequel notre droit de la filiation était construit consistait en un couple marié, formé de personnes de sexe opposé, qui était les parents biologiques des enfants issus de leur mariage », rappelle le juge Andres Garin dans une décision de 105 pages qui vient bouleverser le statu quo — au niveau de la loi, doit-on préciser, car bien des Québécois vivent au jour le jour dans des familles dites « non conventionnelles ». « Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents ? » demande le magistrat en qualifiant la question de simple et de « fort complexe » à la fois. Traditionnellement, la réponse était non. C’est d’ailleurs le mur qu’a frappé le trouple — contraction des mots trio et couple — formé de Rose, Marc et Sophie (à noter qu’il ne s’agit pas de leurs véritables noms, puisque la loi interdit d’identifier les parties d’un litige en droit familial). Ces derniers ont porté cette cause à bout de bras avec leurs avocats, Me Marc-André Landry et Me Bernard Amyot, qui ont œuvré pro bono dans cette affaire. Deux autres familles ont ensuite greffé leurs causes à la leur. Le juge Garin souligne que, depuis 1980, le droit québécois a évolué pour reconnaître la validité de divers modèles familiaux. « Pourtant, un aspect du modèle familial traditionnel — l’idée qu’un enfant ne peut avoir plus de deux parents — demeure ancré, semble-t-il, dans le droit de la filiation », écrit-il. L’histoire d’une famille Au début de leur histoire, Rose s’est mariée avec Marc, qu’elle fréquentait depuis une dizaine d’années. Trois enfants sont nés de leur union. Puis, Rose a fait la rencontre de Sophie et a développé une relation amoureuse avec elle. Elle l’a présentée à Marc et, depuis, ils forment un trio amoureux exclusif. Sophie a exprimé le désir d’avoir un enfant. Le projet est devenu celui des trois adultes. Lorsque Simon est né en 2022, ils ont choisi d’inscrire sur le certificat de naissance — qui ne permet que deux noms — ceux de Sophie et de Rose. L’État civil a effacé celui de Rose, car le père biologique avait été honnête et a signalé dès le début son intention d’être reconnu père. Bref, cet enfant qui peut se targuer d’avoir trois parents n’en avait finalement qu’un seul aux yeux de la loi. Les embûches peuvent être nombreuses pour le parent non officiellement reconnu : il ne s’agit pas que de voir son nom sur un bout de papier, mais bien d’avoir des droits, comme la garde de son enfant en cas de rupture, et, pour la progéniture, la possibilité de lui réclamer un soutien financier. On peut aussi penser au parent qui peut être empêché de consentir aux soins de son enfant blessé ou de le faire bénéficier de son assurance dentaire, entre autres exemples. « En somme, l’absence d’un lien de filiation occasionne un désavantage sociojuridique tant pour le parent non reconnu que pour son enfant », note le magistrat, qui renchérit : il cause aussi un « préjudice psychologique et identitaire aux membres des familles pluriparentales ». Une reconnaissance juridique Les trois parents « en pleuraient de joie » vendredi, a déclaré Me Landry, lui-même très ému du résultat. Sophie a dit à ses procureurs qu’elle ne pouvait imaginer de jugement « aussi représentatif de leur famille », a ajouté Me Amyot. Cette reconnaissance est aussi importante pour ces familles québécoises, comme le signale le juge Garin. « En fin d’analyse, la limite de deux liens de filiation transmet aux familles pluriparentales et à la société en général le message que seules les familles dites “normales”, avec un maximum de deux parents, représentent des structures familiales valides et dignes de reconnaissance juridique. Ce message renforce et perpétue le désavantage subi par ceux et celles qui évoluent dans un modèle familial non traditionnel. » Il a jugé que les articles du Code civil qui conçoivent les familles comme n’ayant que deux parents portent atteinte au droit à l’égalité. Il estime qu’elles sont discriminées en fonction de leur statut familial, « dans le sens de l’appartenance à un modèle familial particulier ». Ce motif de discrimination n’est pas inscrit dans la Charte des droits et libertés, mais il a été considéré comme un « motif analogue » — et le fait que le juge l’ait retenu est « marquant », relève Me Landry. Avec ce jugement, « tout le temple » du droit familial est secoué, estime l’avocat. Me Amyot juge pour sa part que cette décision est presqu’aussi importante que celle qui a reconnu le mariage pour tous au début des années 2000. Le juge Garin a ainsi déclaré inopérants 44 articles du Code civil, mais il a suspendu leur invalidité pour 12 mois, afin de donner le temps au législateur de corriger le tir et d’en arriver avec une version qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés. Il a aussi ordonné au directeur de l’État civil d’ajouter le nom de Marc au certificat de naissance de Simon. Le gouvernement du Québec avait défendu les dispositions attaquées devant la Cour supérieure. Vendredi après-midi, le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a fait savoir qu’il désirait prendre le temps d’analyser le jugement avant de le commenter. Il peut aussi le porter en appel.







![[Clin d’œil] Les tauliers se rebiffent](https://media.letelegramme.fr/api/v1/images/view/680bb3cec20eb28af90dc3dd/web_golden_xxl/680bb3cec20eb28af90dc3dd.1)



![Randonnée facile à Saint-Gildas-de-Rhuys : de l’abbaye du VIe siècle au panorama grandiose du Grand Mont [Carte]](https://media.letelegramme.fr/api/v1/images/view/680b9b4f60b6de4ffb07f81d/web_golden_xxl/680b9b4f60b6de4ffb07f81d.1)