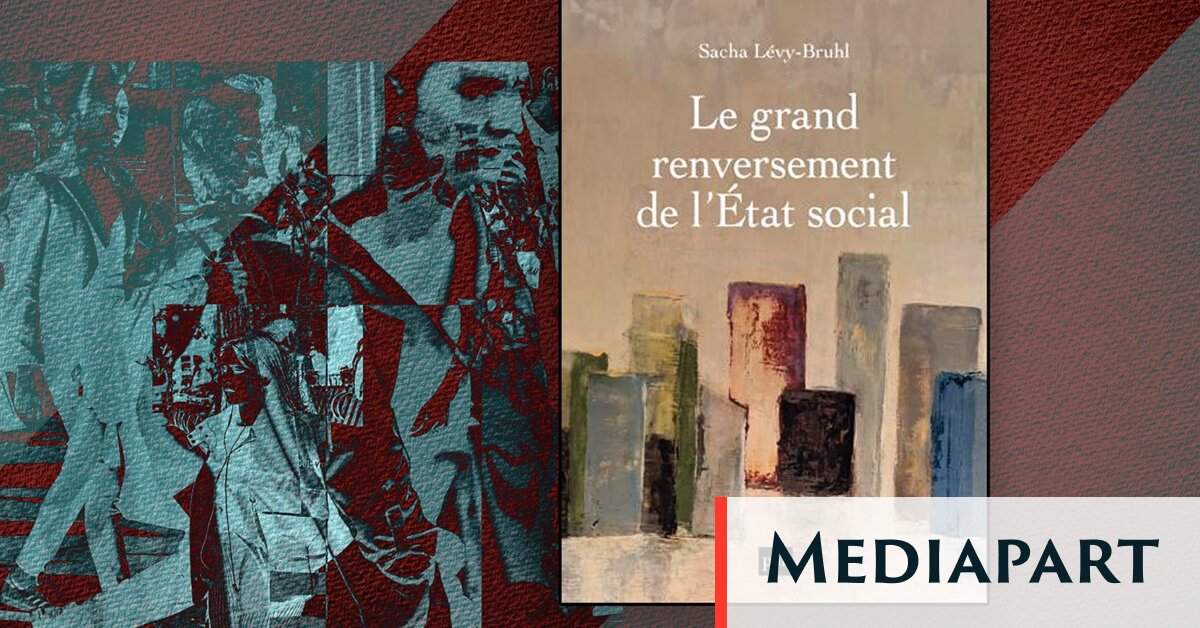L’Education nationale a-t-elle une doctrine claire pour sanctionner un prof violent ? (Spoiler : Non)

«Nous avons connu un prof de maths en classes préparatoires à Paris, qui martyrisait ses élèves. Il y avait des violences physiques et morales. Il avait par exemple attrapé une élève par les cheveux et les avait utilisés pour essuyer le tableau. Il ne s’est rien passé pendant trois ou quatre ans, malgré les alertes au rectorat. En revanche, dans un autre cas d’une professeure dans la même ville qui faisait fermer les rideaux de la classe et éteindre les lumières, une mesure conservatoire a été prise très rapidement par le chef d’établissement, proche de la retraite, qui est allé la voir tout de suite et l’a suspendue. On est très mal informés des sanctions prises contre les professeurs, mais le sentiment qui domine, c’est qu’il n’y a pas de doctrine claire », témoigne Emmanuel Garot, ancien vice-président de la PEEP de Paris. Pas de doctrine claire, c’est aussi ce qui est ressorti d’une table ronde organisée dans le cadre de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, le 9 avril dernier, où étaient présents quatre recteurs et rectrices, et deux « Dasen », les directeurs académiques des services de l’Éducation nationale. Le rapporteur Paul Vannier, député LFI, a posé la question suivante : « Quels sont les textes qui fixent la doctrine des rectorats en matière mesure conservatoire et de sanctions disciplinaires ? Et cette doctrine est-elle uniforme à l’échelle nationale ou laissée libre à l’appréciation des recteurs ? » Les réponses des différents responsables ont laissé entrevoir le plus grand flou. Des pratiques qui diffèrent selon les académies Pour la rectrice de l’Académie de Paris, Julie Benetti, c’est « le cadre législatif qui fixe la doctrine des rectorats ». Lâchant ensuite cette précision qui résume tout : « A supposer qu’il y ait véritablement une doctrine en matière de mesures conservatoires et de sanctions disciplinaires. » Tout est dit : il n’y en a pas. S’exprimant dans la foulée, Hélène Insel, qui vient de quitter son poste de rectrice de l’académie de Grenoble pour prendre le même poste à Rennes, a d’ailleurs observé en passant d’une région à l’autre que les « pratiques pour les mesures conservatoires diffèrent selon les territoires ». A savoir, les mesures prises pour protéger les enfants lorsqu’il y a une situation de violence probable, et qu’un prof ou un personnel est suspect. Si « les textes dans le code de l’Education sont clairs », Hélène Insel observe qu’on peut « lire un article du code de manière différente » selon sa sensibilité et les habitudes de son rectorat. « Je préfère prendre une mesure conservatoire assez rapidement », argumente-t-elle. « Pas de doctrine du tout » Contactés par 20 Minutes, plusieurs syndicats de l’Education nationale confirment ce flou artistique. « D’un rectorat à un autre, ce n’est pas traité de la même façon, explique Sandra Gaudillère, secrétaire nationale de la CGT Educ’ation. Il n’y a rien d’écrit, pas de ligne nationale. » « Il y a des différences d’appréciation qui conduisent à prendre ou non des mesures conservatoires et à donner suite ou non à des signalements. Il manque ce cadre qui s’appliquerait partout sur la procédure à suivre, regrette Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat dans le second degré. « Ils n’ont pas de doctrine claire, et même pas de doctrine du tout. C’est un peu en fonction de la qualité de la personne au rectorat… Des académies ont des politiques très fermes vis-à-vis d’agresseurs, et dans d’autres ça va être très difficile de faire suspendre le suspect d’une agression », commente Marion Maurice-Jasseron, cosecrétaire de Sud Education. L’académie de Créteil répugnerait à utiliser des mesures conservatoires contre les profs violents, selon la syndicaliste, tandis que l’académie de Toulouse aurait selon elle des « prises de position beaucoup plus claires sur les violences sur les enfants avec des mesures conservatoires plus rapides et des commissions disciplinaires. » Accompagner d’abord, sanctionner ensuite Pour Hélène Insel, la difficulté à prononcer des mesures de suspension provisoires des profs et personnels impliqués s’expliquerait notamment parce que les organisations syndicales « feraient de la mesure conservatoire une mesure disciplinaire », alors qu’il s’agit d’une mesure qui selon elle « protège l’élève en cas de suspicion de maltraitance mais aussi la personne accusée ». Selon la secrétaire générale du SE-Unsa, Elisabeth Allain-Moreno, il y aurait une autre explication à cela : l’administration ne réagirait pas assez vite aux différentes alertes des personnels, qui auraient permis à une situation de ne pas dégénérer : « Un employeur peut se faire déborder lorsqu’il sanctionne par une communauté éducative qui estime que personne n’est venue rectifier le tir. Quand un personnel est violent, il n’y a pas d’excuse possible, mais cela doit nous questionner sur le système qui a permis cela. Comment administrer une sanction si à aucun moment notre système n’a accompagné la personne [fautive] ? » « On ne nous donne jamais les explications » Les fédérations de parents ne sont quant à elles pas du tout informées des sanctions prises à l’encontre des personnels. « On est rarement mis dans la boucle », constate Martin Raffet, de la FCPE. « On ne nous donne jamais les explications », regrette Laurent Zameczkowski, de la Peep. Ce problème d’absence de doctrine claire sur les sanctions ou les mesures de protection des enfants n’est qu’un aspect du problème plus général, selon Marion Maurice-Jasseron, de l’absence de prise en compte suffisante des violences faites aux enfants. « Cela n’est pas un sujet dont l’Education nationale s’est saisi », estime la responsable. En témoigne l’absence de chiffres clairs sur le sujet, qui commencent tout juste à être communiqués.