L’Europe s’inquiète de bactéries coriaces repérées dans la nourriture
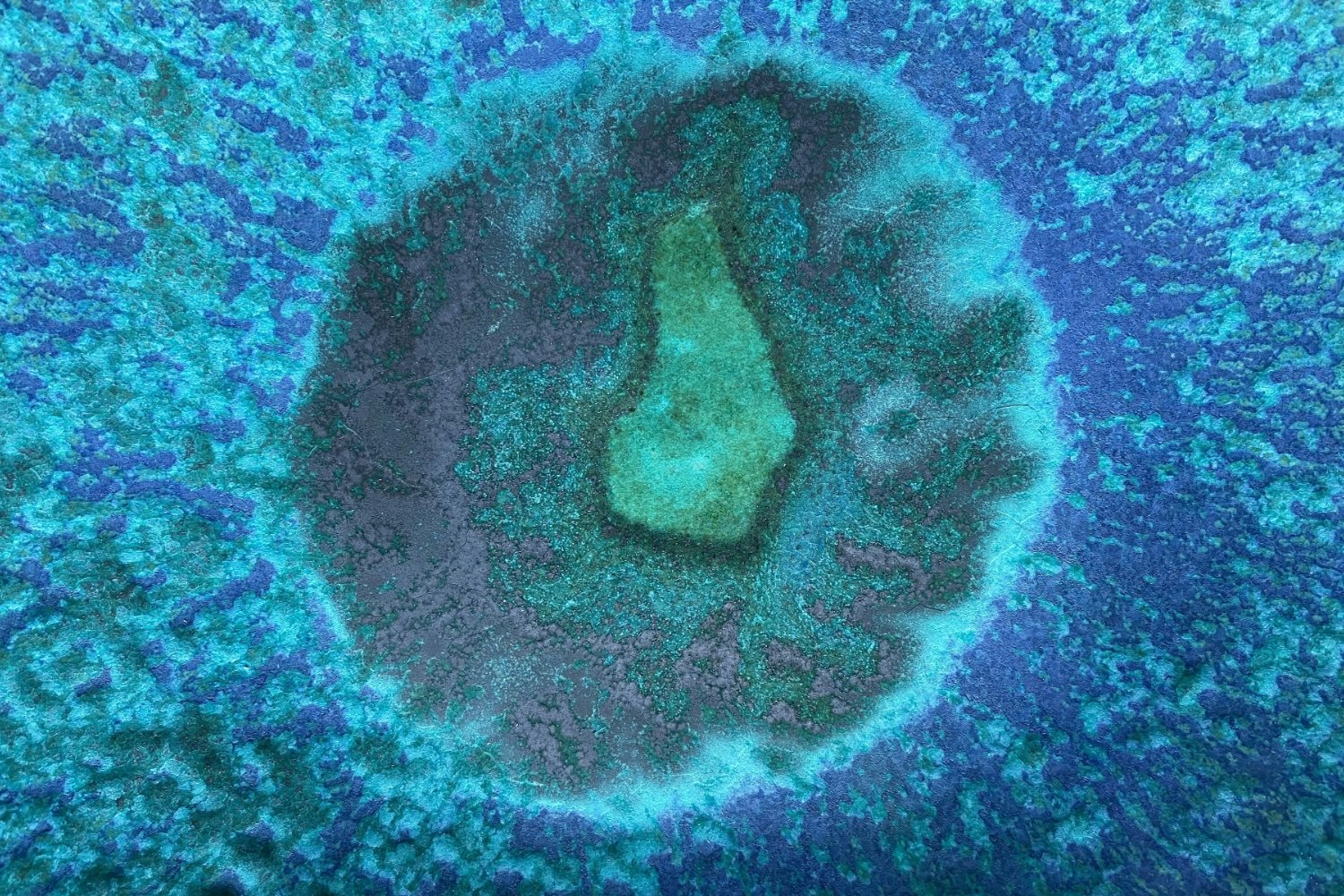
On les appelle carbapénémases. Derrière ce nom barbare, se cachent des enzymes produites par certaines bactéries, capables de rendre inefficaces les antibiotiques les plus puissants, les fameux carbapénèmes. Ces médicaments sont utilisés en dernier recours, quand plus rien ne marche. Le problème, c’est que ces bactéries ont été retrouvées dans la chaîne alimentaire. Des bactéries qui résistent à (presque) tout Depuis 2011, 14 pays européens (dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou encore la Suède) ont identifié ces bactéries résistantes dans les élevages, notamment chez les porcs et les bovins. Et la tendance n’est pas vraiment à la baisse. L’Italie a connu un pic en 2021, suivie par l’Espagne et le Portugal en 2023. Même si elles sont encore rarement repérées dans la viande en supermarché, leur présence dans les élevages devient de plus en plus fréquente. Les bactéries concernées ? Des habituées du genre, comme E. coli, Klebsiella ou Salmonella. Elles se baladent tranquillement dans les intestins des animaux, parfois dans les produits dérivés, et peuvent développer des résistances si elles croisent trop souvent des antibiotiques. Et même si les contrôles existent, l’autorité de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît qu’ils sont encore trop limités : peu d’études se penchent, par exemple, sur les produits de la mer ou les légumes. Est-ce que ces bactéries peuvent passer de la viande à l’homme ? Pour l’instant, rien n’est sûr. Mais il y a des indices. Certaines souches retrouvées chez l’humain sont quasiment identiques à celles détectées dans les animaux. En 2022 et 2023, des cas humains de Salmonella enterica résistante aux carbapénèmes ont été recensés, et si la même souche n’a pas été retrouvée dans les élevages, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Autre élément troublant : des morceaux d’ADN porteurs des gènes de résistance (des plasmides) ont été retrouvés à la fois chez des bactéries animales et humaines. Cela ne prouve pas qu’il y a transmission par la nourriture, mais ça mérite d’être creusé. Dix pays de l’UE ont déjà mis en place des plans pour suivre et contenir ces bactéries. L’EFSA recommande d’élargir la surveillance à plus de types d’aliments, de renforcer les méthodes de détection et de mener des enquêtes pour comprendre comment ces microbes circulent.

















